Il s’agit d’une espèce envahissante qui menace les écosystèmes côtiers et plusieurs espèces prisées par les amateurs de fruits de mer, comme les huîtres, les moules et le homard. Le crabe vert est au cœur d’un projet de recherche international mené par Annabelle Lamoureux et Hugo Vidal, qui étudient à la maîtrise en biologie.
Originaire d’Europe, le crabe vert (Carcinus maenas) a été observé au Canada dès les années 1950. Au Québec, il a été répertorié aux Îles-de-la-Madeleine à compter de l’année 2004. L’invasion du crabe vert au Canada provient de deux lignées; une d’origine sud-européenne plus tolérante à la chaleur et une Norvégienne plus tolérante au froid. « Le crabe vert est une espèce envahissante aux impacts écologiques et économiques majeurs », observe le directeur du Laboratoire de physiologie écologique et évolutive marine, le professeur Piero Calosi. « Sa pression prédatrice peut perturber les populations d’espèces marines d’intérêt commercial et, par conséquent, avoir un impact sur les pêches dans les régions côtières. »
Actuellement, le crabe vert est présent dans les Maritimes, aux Îles-de-la-Madeleine et en Colombie Britannique. « Son aire de répartition s’étend de façon imminente vers le Québec continental », souligne le professeur Calosi. « Considérant son impact sur les écosystèmes, il est important d’en apprendre davantage sur la biologie de cette espèce, pour pouvoir prédire l’expansion de sa répartition géographique afin de protéger les ressources marines et les économies côtières. »

Cette surveillance est d’ailleurs au cœur des projets de maîtrise d’Annabelle Lamoureux et d’Hugo Vidal, qui sont dirigés par le professeur Calosi et auxquels collaborent des partenaires de l’Institut Maurice-Lamontagne (IML) du ministère de Pêches et Océans et l’Université NOVA de Lisbonne. « Nos travaux portent sur une question de plus en plus urgente dans un contexte de changements climatiques et globaux : comment différentes lignées génétiques d’une espèce envahissante réagiront-elles aux variations de température », résume Hugo Vidal.
Récemment, Hugo Vidal a réalisé, en collaboration avec les biologistes-chercheurs Kathleen MacGregor et David Drolet de l’Institut Maurice-Lamontagne, des expériences dans une salle de bassins contrôlée de l’IML conçue spécialement pour l’étude d’espèces envahissantes. Il y a analysé les traits de performance écophysiologiques des crabes issus de différentes lignées présentes au Canada en plus de les exposer à un large gradient de températures allant des eaux froides caractéristiques du Saint-Laurent aux températures plus chaudes rencontrées dans certain secteur des Îles-de-la-Madeleine et des Maritimes.
« Afin de compléter mes analyses, je me suis rendu directement sur le terrain, aux Îles-de-la-Madeleine », poursuit le chercheur. « J’ai pu comparer les taux métaboliques des crabes en milieu naturel avec ceux mesurés en laboratoire, pour tenir compte de l’influence de la complexité des milieux naturels, et valider ces données dans l’optique de contribuer à une gestion réfléchie et efficace du crabe vert. » Les résultats préliminaires d’Hugo Vidal indiquent que les différentes populations répondent de manière différente au stress thermique.
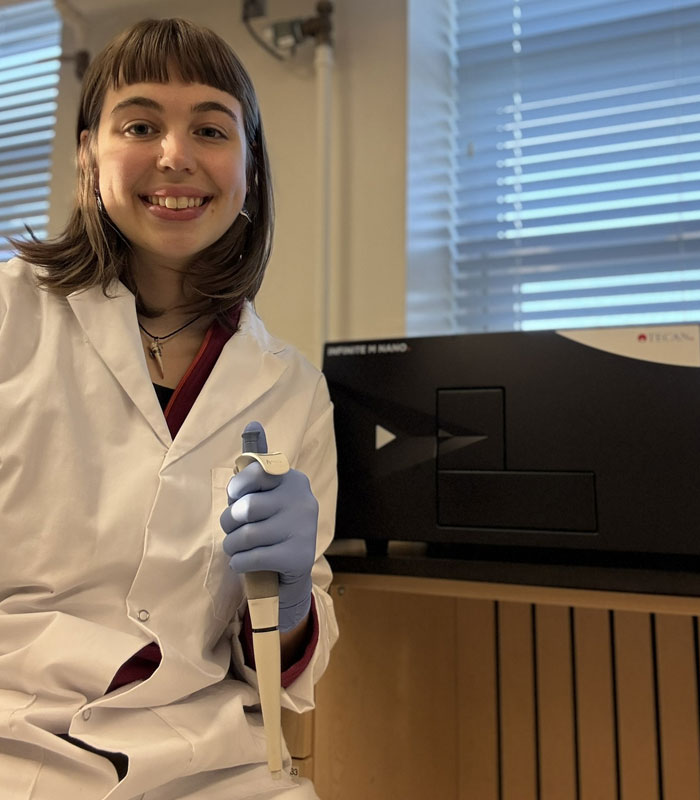
De son côté, Annabelle Lamoureux mène ses travaux au Portugal, dans le SeaTox Laboratory de l’Université NOVA de Lisbonne, en collaboration avec la professeure Carolina Madeira. Elle y caractérise la réponse thermique à partir de biomarqueurs liés à la tolérance thermique et au stress oxydatif à partir d’échantillons collectés au printemps à l’Institut Maurice-Lamontagne. « La température influence de façon fondamentale tous les aspects de la physiologie des organismes, surtout ceux à sang froid, en agissant sur la vitesse des réactions et sur les propriétés physiques des molécules biologiques, comme les enzymes par exemple. Ces marqueurs nous aident à comprendre comment les individus réagissent au stress thermique au niveau cellulaire et ainsi prédire comment la température influencera leur capacité d’invasion », explique Annabelle Lamoureux.
Les résultats de ces deux projets de recherche contribueront à affiner les prédictions sur l’expansion future du crabe vert au Québec et au Canada, conclut le professeur Calosi. « Ils offriront également aux gestionnaires des informations précieuses pour développer des stratégies de gestion pour protéger les écosystèmes côtiers, tant afin de préserver la biodiversité marine que de soutenir les activités de pêche traditionnelles et commerciales. »
Pour nous soumettre une nouvelle : communications@uqar.ca



