Il s’agit de l’une des plus grandes tragédies maritimes du Canada. En 1711, neuf à dix navires de la flotte dirigée par l’amiral Walker se sont échoués dans la région de la Côte-Nord. Bilan : plus de 1000 personnes y ont perdu la vie. Afin de mieux comprendre ce naufrage, une équipe intersectorielle mène des travaux de recherche inédits sur cet événement phare de la Nouvelle-France.
Intitulé Le naufrage de la flotte Walker, archéologie d’un lieu de mémoire maritime, le projet de recherche rassemble des chercheuses et chercheurs en histoire, en lettres, en archéologie et en sciences de la mer. Une partie des travaux bénéficie du soutien du programme Transformer l’action pour le climat.
La tragédie est survenue dans la nuit du 3 septembre 1711. En pleine guerre de Succession d’Espagne, les Anglais voulaient conquérir la Nouvelle-France en attaquant Québec et Montréal. Une flotte d’environ 85 navires comptant 6000 marins et 5300 soldats menée par l’amiral Hovenden Walker se dirigeait vers Québec, alors que près de 1500 soldats et miliciens de la Nouvelle-Angleterre et 800 alliés haudenosaunee (iroquois) s’étaient massés près du lac Champlain en vue d’attaquer Montréal.
Le naufrage eut lieu près de l’île aux Œufs, à deux kilomètres au large du territoire actuel de la ville de Port-Cartier. Selon les sources, neuf ou dix navires de la flotte se sont échoués contre les récifs de l’île, entraînant la mort de 1000 à 1300 personnes et de plusieurs animaux à bord. « Cet événement aura des répercussions considérables dans l’histoire canadienne, repoussant la Conquête de près d’un demi-siècle », observe le professeur d’histoire et codirecteur du projet Maxime Gohier. « Notre programme de recherche vise, entre autres, à mieux comprendre les circonstances du drame et les traces mémorielles et matérielles qu’il a laissées. »

La brume, les vents et l’absence de pilotes ayant une connaissance suffisante du Saint-Laurent sont les causes probables de la tragédie. Dans le cadre du projet, l’équipe de recherche étudie des documents, des récits, des représentations artistiques, des initiatives patrimoniales et des vestiges archéologiques et matériels, croisant ainsi les sphères de l’histoire, de la littérature, de l’histoire de l’art, de l’archéologie, du patrimoine, de la géologie marine et de l’océanographie physique.
En plus de documenter un moment marquant de l’histoire de la Nouvelle-France, l’équipe a mis en évidence un énorme potentiel de cueillette de données anciennes à propos du climat du Saint-Laurent. « En reconstruisant la trajectoire des navires de la flotte à partir de l’information contenue dans les carnets de bord des officiers de la marine anglaise, nous avons pris conscience que les bases de données internationales qui répertorient les données climatiques issues de journaux de navigation ne contiennent à peu près aucune information sur le Saint-Laurent. Or, ces données sont cruciales pour la reconstruction du climat de l’époque préindustrielle et pour la création de modèles plus fiables des changements climatiques », indique le professeur en océanographie et codirecteur du projet Dany Dumont. « Considérant que le Saint-Laurent est à cette époque l’une des régions les plus naviguées au monde, la quantité potentielle de nouvelles données sur le climat maritime ancien est inouïe, » poursuit-il.
Plusieurs autres initiatives sont dans les cartons de l’équipe de recherche jusqu’en 2029. Elle prévoit se rendre sur la Côte-Nord pour recueillir des témoignages oraux et tenir des kiosques d’archéologie publique au cours des deux prochaines années. Les chants composés à l’époque du naufrage seront enregistrés à l’automne 2025 par les musiciens de La Nef, une œuvre d’art public devrait être produite l’an prochain et une édition critique d’une épopée écrite en Nouvelle-France au moment des événements est en cours de préparation. Une université d’été sur l’histoire maritime de la Nouvelle-France est aussi prévue à l’UQAR en 2027. La publication d’une monographie faisant la synthèse des recherches devrait être publiée en 2029. « Nous souhaitons que l’ensemble de nos travaux apporte l’éclairage nécessaire pour mieux comprendre cette tragédie maritime et sa place dans notre histoire », souligne la codirectrice du projet et professeure associée de l’UQTR Marie-Ange Croft.
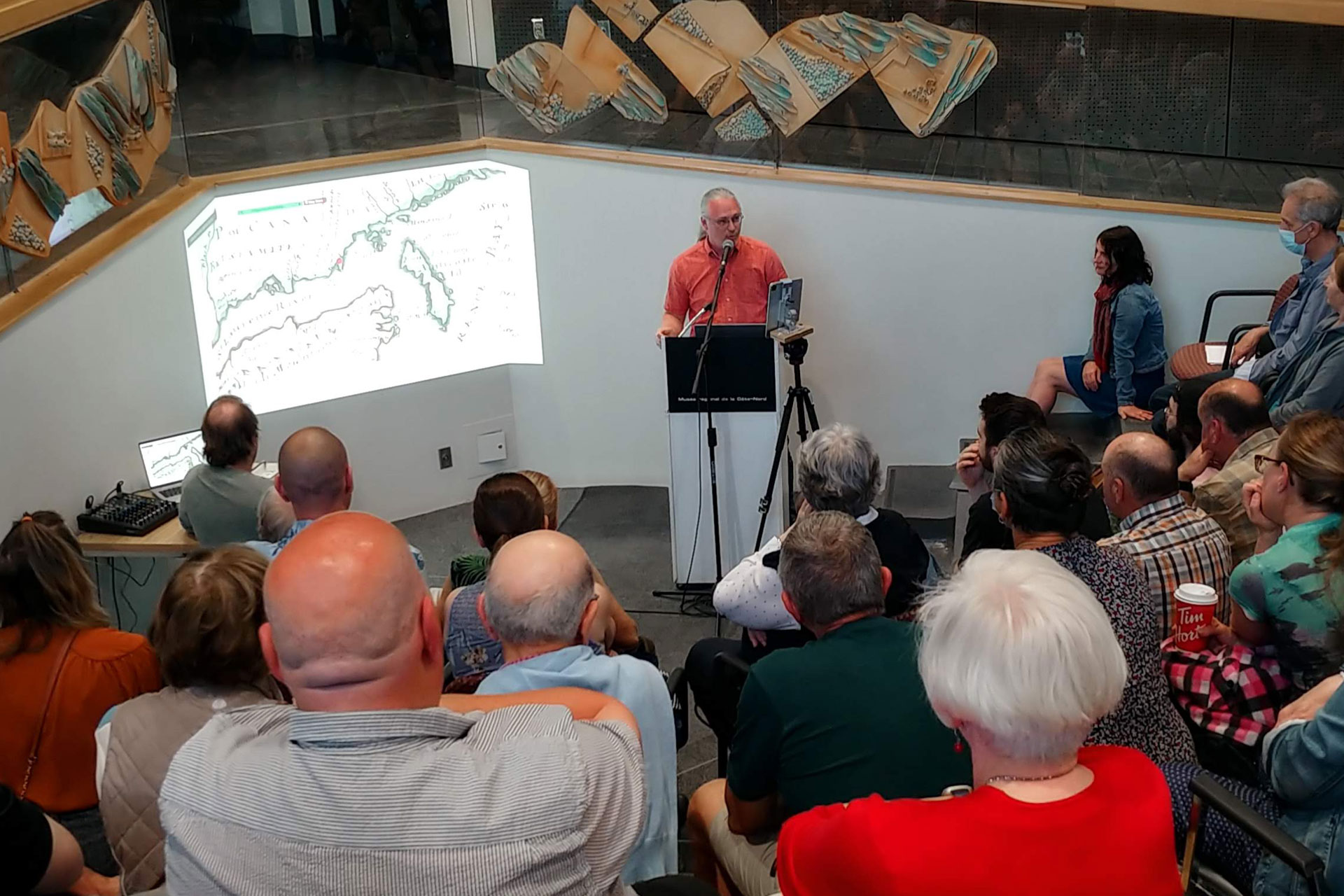
Le naufrage de la flotte Walker, archéologie d’un lieu de mémoire maritime témoigne de la portée que peut avoir un projet de recherche mené en collaboration entre chercheuses et chercheurs de différentes disciplines scientifiques. « La démarche interdisciplinaire du projet Walker est si porteuse qu’elle a été adoptée par d’autres projets similaires visant à mieux comprendre et documenter la relation entre les populations et les territoires côtier soumis aux changements sociaux et environnementaux », conclut le professeur Gohier.
Pour nous soumettre une nouvelle : communications@uqar.ca



